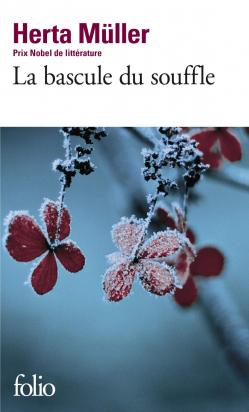
- Traduit de l'allemand par Claire de Oliveira -
.
Une grande lecture que ce roman de Herta Müller, dont je n’avais lu que Le renard était déjà le chasseur, il y a longtemps.
Le narrateur, membre d’une famille germanophone de Roumanie, a 17 ans. Il prépare sa valise, il sait que les Russes vont venir le chercher pour le transférer dans un camp.
« En janvier 1945, c’était encore la guerre. Affolé de me voir partir en plein hiver chez les Russes, on ne savait trop où, chacun avait voulu me donner quelque chose, qui n’arrangerait rien mais serait peut-être utile. Car il n’y avait pas le moindre arrangement possible, on ne pouvait rien y changer, j’étais sur la liste des Russes; chacun m’avait fait un cadeau à son idée. Je l’avais accepté en me disant, du haut de mes dix-sept ans, que ce départ arrivait à point nommé. La liste russe, j’aurais certes pu m’en passer, mais partir me ferait vraiment du bien, à moins que ça ne tourne au vinaigre. Je voulais quitter ma petite ville, ce dé à coudre où toutes les pierres avaient des yeux. Au lieu d’avoir peur, je dissimulais mon impatience tout en ayant mauvaise conscience, car cette liste qui faisait le désespoir de mes proches était pour moi de l’ordre de l’acceptable. Ils craignaient qu’il ne m’arrive des histoires à l’étranger. Moi, je voulais gagner un endroit où je serais inconnu.»
En postface, Herta Müller rappelle les faits : durant la Seconde Guerre Mondiale, la Roumanie, occupée par l’Armée rouge, capitule en 1944 après avoir été dirigée par un dictateur fasciste. Cette année-là, elle déclare la guerre à son ancien allié, l’Allemagne nazie. A partir de janvier 1945, le gouverneur soviétique exige du gouvernement roumain que les Allemands vivant en Roumanie soient évacués vers l’URSS pour participer à la « reconstruction». Tous les hommes et femmes de 17 à 45 ans furent déportés. Ce fut le cas pour la mère d'Herta Müller ( elle-même née dans la minorité allemande des Souabes, en Roumanie, en 1953. Les persécutions l'améneront à émigrer en Allemagne de l'Ouest en 1987 ).
« Aucun de nous n’avait fait la guerre, mais pour les Russes, nous étions responsables des crimes d’Hitler, étant allemands.»
Pourquoi ce jeune homme veut-il partir, sans informer sa famille de son souhait ? Nous l’apprenons très vite : simplement parce qu’il est homosexuel, il lui est impossible de le vivre autrement que clandestinement, en prenant des risques.
« A l’époque, juste avant le camp, on risquait la prison à chaque rendez-vous, et après mon retour au pays c’était exactement la même chose, jusqu’à mon émigration en 1968. [...] Et à l’époque du camp, si je m’étais fait pincer sur place, on m’aurait tué. [...] Avant, pendant et après le camp, pendant vingt-cinq ans, j’ai vécu dans la peur de l’Etat et de ma famille.»
Ainsi, dès les premières pages le malaise et l’émotion nous rejoignent, parce que nous savons que ce départ va « tourner au vinaigre». Ce camp, ce sera une vie d’interné, de bagne, de travaux forcés. Notre narrateur - dont nous apprenons tardivement le nom : Leopold Auberg - y restera cinq ans, il y survivra.
Ce roman nous raconte le camp, en chapitres courts comme des chroniques, des scènes abordant tous les aspects, y revenant parfois en boucle, tel l’ange de la faim :
« Que dire de la faim, quand elle est chronique. On peut dire qu’il y a une faim qui fait souffrir de la faim. Elle s’ajoute, encore plus affamée, à celle qu’on avait déjà. Cette faim toujours nouvelle croît de façon insatiable et, d’un bond, se coule dans l’éternelle faim qu’on s’évertue à tromper. Comment errer de par le monde quand on a plus rien à dire de soi, sinon qu’on a faim. [...] La transparence de notre crâne nous donnait l’air d’avoir avalé un excès de lumière vive. Le genre de lumière qui se regarde elle-même dans la bouche, se glisse à l’intérieur de la luette pour la faire enfler, monter jusqu’au cerveau. Alors, en guise de cerveau, on n’a plus dans la tête que l’écho de la faim. Il n’y a pas de mots adéquats pour dire la souffrance de la faim. Aujourd’hui encore, je dois montrer à cette faim que j’y ai échappé. C’est tout bonnement la vie que je mange, depuis que je n’ai plus le ventre creux.»
Ce sont les baraques, la déportation et le mal du pays, les travaux de manœuvres ( charbon, ciment... ) les poux, les punaises, les grammes de pain et la soupe, les compagnons dont nous faisons peu à peu connaissance, la direction du camp, la mort et les mécanismes de survie dans ce « hors du temps, hors de nous. Hors du monde qui en avait fini avec nous, si ce n’était l’inverse.»
La plume est précise, descriptive, technique même et pourtant sobre sur les souffrances, saisissante par cette façon de raconter en intégrant tout ce réel ( l'horreur parmi les paysages, le ciel, le vent, les objets ) dans le ressenti du narrateur, en donnant vie à tout l’environnement malgré l’étrangeté dans ce contexte. Un paradoxe. Certaines descriptions et réflexions peuvent paraître absurdes alors qu’elles sont puissamment signifiantes, significatives; des « mots d’évasions».
Tout au long de ma lecture, j’ai pensé au magnifique roman d'Olga Tokarczuk Dieu, le temps, les hommes et les anges.
J’ai été impressionnée par cette écriture, témoignant de ressources mentales pour survivre, qui sont bien plus que de l’ironie, une pensée qui concentre et décentre à la fois l’esprit. C’est la bascule du souffle, garder son souffle, ne pas basculer.
« L’ange de la faim regarde sa balance et dit :
Tu n’es pas encore assez léger, pourquoi ne pas lâcher prise...
Je réponds : tu me trompes avec ma chair. Elle est ton esclave. Mais je ne suis pas ma chair. Je suis autre chose, et je ne vais pas lâcher prise. Autant oublier qui je suis; et ce que je suis, je ne te le dirai pas. Or c’est ce qui fausse ta balance.»
Le récit ne se limite pas au camp. Il y a les souvenir de la vie durant la guerre, la propagande, et ceux d’après le camp, le retour difficile, impossible.
« Je savais qu’à mon retour l’effroi avait été plus grand que la surprise; on avait éprouvé du soulagement, pas de la joie. J’avais trompé leur deuil, en étant vivant. Depuis que j’étais revenu à la maison, tout avait des yeux et voyait que mon mal du pays, sans maître, ne s’en allait pas. [...] J’étais enfermé en moi et j’en étais expulsé, je ne leur appartenais pas et je me manquais à moi-même.»
.
« ... je voulais surtout passer inaperçu à mes propres yeux. Il est une loi intérieure, et je ne le savais que trop, qui vous interdit de vous mettre à pleurer quand on a trop de raisons de le faire. Je me persuadais que ces larmes étaient dues au froid, et je me crus.»
.
- Lecture d’Herta Müller, prix Nobel de littérature 2009, partagée avec Passage à l’Est -
*
Commentaires
1 Aifelle Le 06/05/2022
marilire Le 07/05/2022
2 keisha Le 06/05/2022
marilire Le 07/05/2022
3 Dominique Le 06/05/2022
marilire Le 07/05/2022
4 nathalie Le 07/05/2022
marilire Le 07/05/2022
5 A_girl_from_earth Le 07/05/2022
marilire Le 09/05/2022
6 Passage à l'Est! Le 23/05/2022
marilire Le 24/05/2022