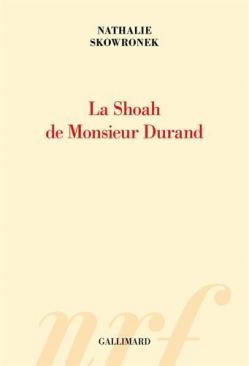
- Gallimard -
.
En 2011, j'ai lu Karen et moi de Nathalie Skowronek. Et ce fut une rencontre. En 2014, j'ai pu lire son second roman Max, en apparence, avec la même émotion. J'espérais le troisième livre. Je l'espérais même en début d'année, pouvoir le présenter en avril, lors du mois belge organisé par Anne et Mina. J'ai été exaucée. C'est le moins que je puisse écrire. Ce titre est paru le 02 avril. Et c'est un essai.
" En 2013, j'ai fait paraître un livre, Max, en apparence. J'y retraçais le parcours de mon grand-père, Max donc, rescapé, non pas d'Auschwitz comme je l'ai longtemps pensé, mais d'un camp annexe construit autour de la mine de Jawischowitz, à dix kilomètres de là. [...]. En vérité, je n'étais sûre de rien. Je m'intéressais autant à lui qu'à l'impact qu'avait eu sa vie sur nos propres vies. Je me demandais comment cette histoire, celle-là et celle de milliers d'autres avaient glissé jusqu'à nous. "
Comme l'indiquent ces premières lignes, dans ce texte, à travers les recherches effectuées, sa démarche pour l'écriture de Max, en apparence, Nathalie Skowronek réfléchit sur la mémoire de la Shoah, l'évolution de cette mémoire, les périodes de cette mémoire, ses représentations, et des mécanismes de l'oubli, ses causes et conséquences, elle qui est de la " troisième génération " alors que la Shoah parvient-revient maintenant à la quatrième génération. Ce qui devient l'après mémoire de la Shoah.
Nathalie Skowronek, d'un ton juste, sans prétention et sans compromis au " politiquement correct " raconte, sur une cinquantaine de pages, " les époques-étapes " de cette mémoire, celle du retour des rescapés, retour à la vie, la transmission par le silence de plomb qui pèsera sur la génération suivante, puis la transmission par les mots et les images. La réalité de la Shoah par le témoignage d'abord par " ceux qui reviennent de là-bas. De Pitchipoï, dit-on dans un emprunt au yiddish, le pays de nulle part ", par " l'étude " au point de créer un " imaginaire " de la Shoah, des images " iconiques ". Elle souligne ce mouvement de la mémoire, les rescapés raconteront à leurs petits-enfants ce qui n'a pas pu être dit à leurs enfants. Ce sera cette troisième génération qui partira en quête, autant d'informations que de son histoire familiale, ces " tentatives d'écriture des descendants ", " on déterre " , et la littérature qui s'en mêle.
- " Ecrire, c'était pour moi servir et transgresser -
Nathalie Skowronek nous parle de cette jeune quatrième génération : " Un nouveau monde s'installe, non pas dans l'oubli de l'ancien, ou pas tout à fait, mais dans une forme ambivalente de détachement. Je suis relié à ce passé mais il ne fait plus partie de moi ". Et " la fiction prend le pas sur les témoignages ". Nathalie Skowronek pointe la levée des tabous et des interdits sur le sujet de la Shoah, elle revient sur ce qu'implique la mémoire de la Shoah de l'après-guerre à l'époque contemporaine, l'existence d'Israël, l'antisémitisme, la crainte d'être considéré comme antisémite. Elle nous raconte aussi ces rescapés qui ont immigrés en Israël dès 1948, ce paradoxe, un pays neuf qui refusait de se tourner vers le passé, qui réclamait de se donner tout entier à l'avenir.
" Du petit nombre de survivants de l'Europe ancienne arrive un grand nombre d'immigrants au pays nouveau. Dans les années 1950, un Israélien sur cinq est un rescapé. Seulement le pays, qui doit en partie - petite ? grande ? - son existence aux remords, à la compassion, au désir de réparation d'un monde qui n'a su empêcher la mort dans des conditions atroces des six millions, veut s'inventer un nouveau destin où les Juifs auront cessé d'être des victimes. Il faut aller vite, l'urgence est là : se montrer grands, forts, invincibles. Le slogan de l'époque en dit long : Oublie la diaspora et plante tes racines dans la terre. " Car de ce côté de la Méditerranée, il n'est plus question de rester exsangue. On fait fi du passé. Le passé c'est l'Europe, le passé, nez pincé, c'est la réaction. Prière de ne pas emporter vos vieilles frusques avec vous. Comprenez-nous bien. Ne nous forcez pas à répéter. A cela, au moins, deux bonnes raisons. Un : elles n'ont rien à faire ici; deux : il nous est trop pénible de s'interroger sur ce qu'elles disent ( que s'est-il passé en Europe ? comment cela a-t-il été possible ? ). Aux rescapés de se fondre dans leur nouvelle peau. Laquelle va de pair avec une nouvelle langue et souvent avec un nouveau nom, hébraïsé. Deux protections valent mieux qu'une. Vous êtes sommés de. Double reniement. "
Avec cette lecture, j'ai retrouvé pour la troisième fois la plume particulière de Nathalie Skowronek, sa singularité qui m'attache tant à ses mots; cette plume déliée et sensible sur cette densité du propos salvateur, sur cette volonté de réflexion ouverte, offerte, avec toutes ses phrases ponctuées de points d'interrogation et ses pistes de réponses, ces pistes, avec cette honnêteté, cette conscience intuitive et clairvoyante. L'aigu de cette conscience.
Plus qu'intéressante lecture qui ne nécessite pas d'avoir lu Max, en apparence. Ce qui ne m'empêche pas de vous recommander les livres de Nathalie Skowronek.
*
Commentaires
1 Anne Le 13/04/2015
2 Laeti Le 13/04/2015
3 Mina Le 13/04/2015
(J'attends confirmation du titre avec lequel commencer selon toi, en me doutant que ce ne sera pas celui-là. Comme Anne, ça m'intéresserait de le lire après Max en apparence ou au moins en ayant appréhendé l'auteur dans la fiction avant).
4 Marilyne Le 13/04/2015
J'attends patiemment ta lecture de " Karen et moi " :)
@ Laeti : De belles lectures, c'est certain. Je viens de voir que ta chronique est publiée, je m'en vais la lire !
@ Mina : je te confirme : " Karen et moi ". Une histoire de femmes. Tu verras, dans chacun des livres, il y a le livre dans le livre, et tous ces autres livres qui accompagnent Nathalie Skowronek.
5 Aifelle Le 14/04/2015
6 Kathel Le 15/04/2015
7 Marilyne Le 17/04/2015
@ Kathel : alors " Max, en apparence " t'attend !
8 Tania Le 26/01/2021